
Les rﺣ۸sultats de la campagne de fouille de Corent 2008 sont disponibles en ligne ﺣ l'adresse suivante :
http://www.luern.fr/Articles%20et%20rapports/Rapport_2008.pdf
Extrait :
Cette huitiﺣ۷me opﺣ۸ration de fouille programmﺣ۸e sur le site du Puy de Corent vient complﺣ۸ter les rﺣ۸sultats de la prﺣ۸cﺣ۸dente campagne triannuelle, consacrﺣ۸e ﺣ lﻗexploration des quartiers situﺣ۸s au nord du sanctuaire Lﻗﺣ۸largissement de la fenﺣ۹tre de fouille, au nord et ﺣ lﻗest du grand complexe C fouillﺣ۸ au cours des deux annﺣ۸es prﺣ۸cﺣ۸dentes, porte lﻗaire dﻗextension des vestiges dﻗﺣ۸poque latﺣ۸nienne bien au-delﺣ de la zone attenante au pﺣ۸ribole. Reconnus sur plus dﻗun hectare, ils sont constitutifs dﻗun quartier central de lﻗoppidum, organisﺣ۸ en plusieurs pﺣﺑles dﻗactivitﺣ۸ (politico-religieuses, domestiques, artisanales et commerciales) et occupﺣ۸ de maniﺣ۷re continue entre le troisiﺣ۷me quart du 2e et le milieu du 1er siﺣ۷cle avant notre ﺣ۷re.
Les vestiges dﺣ۸couverts cette annﺣ۸e obﺣ۸issent aux mﺣ۹mes principes de construction, dﻗorganisation, dﻗorientation et dﻗﺣ۸volution que ceux reconnus lors des campagnes prﺣ۸cﺣ۸dentes. Ils sont parfaitement intﺣ۸grﺣ۸s au schﺣ۸ma de trame urbaine mis en ﺣ۸vidence lﻗannﺣ۸e derniﺣ۷re, dont la pertinence se vﺣ۸rifie cette annﺣ۸e ﺣ travers lﻗalignement des limites de parcelles et des faﺣ۶ades de bﺣ۱timents sur plus de cent mﺣ۷tres de distance, de lﻗangle sud-est du sanctuaire aux clﺣﺑture palissadﺣ۸es fouillﺣ۸es ﺣ lﻗextrﺣ۸mitﺣ۸ nord du chantier. Dﺣ۸volus aux activitﺣ۸s domestiques et artisanales, les bﺣ۱timents prﺣ۸sentent plusieurs ﺣ۸tats de construction qui sﻗﺣ۸chelonnent sur plusieurs gﺣ۸nﺣ۸rations, de la fondation de lﻗoppidum ﺣ La Tﺣ۷ne D1a (corps de bﺣ۱timents D, G1-G3, F et H) ﺣ son abandon dans le courant de La Tﺣ۷ne D2 (bﺣ۱timents C5, F et G4).
Certains dﻗentre eux (corps de bﺣ۱timents F et H) se distinguent par leurs dimensions imposantes et la prﺣ۸sence de marqueurs aristocratiques similaires ﺣ ceux dﺣ۸jﺣ reconnus dans les corps de bﺣ۱timents A et B : ﺣ la dﺣ۸couverte de vaisselle mﺣ۸tallique (gobelet de type Idria), dﻗun anneau en or, dﻗun crﺣ۱ne humain et de piﺣ۷ces dﻗarmement (ﺣ۸pﺣ۸e, bouclier), sﻗajoute celle, plus exceptionnelle en territoire arverne, de plusieurs piﺣ۷ces de char (un anneau passe-guide, deux clavettes et une boﺣ؟te de moyeu) ﺣ۸troitement concentrﺣ۸es dans un mﺣ۹me espace. Dﻗautres bﺣ۱timents sont dﺣ۸volus ﺣ un artisanat trﺣ۷s spﺣ۸cialisﺣ۸, ﺣ lﻗexemple dﻗun atelier de bronzier signalﺣ۸ par lﻗempreinte dﻗun billot en place environnﺣ۸ de rejets (sels de cuivre, fragments de creusets et moules ﺣ alvﺣ۸oles, lingots, poids), ou encore, dﻗune fosse comblﺣ۸e de vestiges liﺣ۸s ﺣ lﻗartisanat du plomb, trﺣ۷s rarement attestﺣ۸ sur les sites de lﻗﺣ۱ge du Fer. La fouille des secteurs les moins perturbﺣ۸s par lﻗemprise des bﺣ۱timents latﺣ۸niens confirme quﻗils succﺣ۷dent ﺣ dﻗautres vestiges dﻗhabitat structurﺣ۸s, datﺣ۸s de lﻗﺣ۱ge du Bronze et du premier ﺣ۱ge du Fer, dont lﻗextension semble sﻗinscrire dans le mﺣ۹me ordre de grandeur.
La dﺣ۸couverte majeure de cette campagne rﺣ۸side dans la mise en ﺣ۸vidence dﻗun vaste bﺣ۱timent sur cave, dont lﻗextrﺣ۸mitﺣ۸ occidentale avait dﺣ۸jﺣ ﺣ۸tﺣ۸ recoupﺣ۸e par la fouille de 2007 (bﺣ۱timent C5). Il se prﺣ۸sente sous la forme dﻗune vaste halle longiligne de plus de vingt mﺣ۷tres de long, encadrﺣ۸e par deux rangﺣ۸es de puissants poteaux. Son emprise au sol est occupﺣ۸e par un vaste creusement excavﺣ۸ dans le substrat basaltique, qui se distingue des caves couramment rencontrﺣ۸es sur les oppida de Gaule interne par sa forme allongﺣ۸e et ses dimensions exceptionnelles : plus de 18 m de long pour 2 m de largeur et autant de profondeur, soit une capacitﺣ۸ de prﺣ۷s de 80 m3. Sa superstructure repose sur un dispositif de poutrage fondﺣ۸ sur des solins en pierre, supportant un plancher qui tenait ﺣ۸galement lieu de plafond pour la cave sous-jacente, dont lﻗespace intﺣ۸rieur ﺣ۸tait compartimentﺣ۸.
Le mobilier retrouvﺣ۸ dans le remplissage de la cave, principalement composﺣ۸ dﻗamphores dont le poids cumulﺣ۸ avoisine les 5,6 tonnes de tessons, suggﺣ۷re quﻗelle ﺣ۸tait spﺣ۸cifiquement dﺣ۸diﺣ۸e au stockage du vin. Rejetﺣ۸es en une seule opﺣ۸ration lors du dﺣ۸mantﺣ۷lement du bﺣ۱timent, survenu dans le second quart du 1er siﺣ۷cle avant notre ﺣ۷re, une vingtaine dﻗentre elles ont ﺣ۸tﺣ۸ dﺣ۸posﺣ۸es intactes au fond du creusement. Leur disposition organisﺣ۸e, en association avec des vases ﺣ۸crasﺣ۸s en place, oriente lﻗanalyse vers lﻗhypothﺣ۷se dﻗun dﺣ۸pﺣﺑt volontaire liﺣ۸s ﺣ la condamnation de la cave. La prﺣ۸sence de nombreux ﺣ۸lﺣ۸ments de vaisselle mﺣ۸tallique (fragments de situle, de cruche, de gobelet et de passoire en bronze), dﻗamphores en situation de dﺣ۸pﺣﺑt (dont un col sabrﺣ۸) et de nombreux jetons cﺣ۸ramiques tﺣ۸moignant de transactions effectuﺣ۸es ﺣ cet emplacement, plaident pour un bﺣ۱timent vouﺣ۸ ﺣ lﻗentreposage, mais aussi, ﺣ la vente et ﺣ la consommation sur place du vin importﺣ۸. Cette interprﺣ۸tation peut sﻗappuyer sur des comparaisons avec certains plans de tavernes semi-enterrﺣ۸es (cellae vinariae) reconnus dans le monde romain, notamment ﺣ Rome (Porta Flaminia) et ﺣ Schwarzenacker en Gaule Belgique. Les dimensions de la cave (qui pouvait accueillir simultanﺣ۸ment jusquﻗﺣ deux cent amphores) et sa situation en bordure de la place plaident pour un amﺣ۸nagement ﺣ caractﺣ۷re public, qui tenait peut-ﺣ۹tre ﺣ۸galement lieu de local de rﺣ۸union pour des corporations dﻗartisans.
Cette annﺣ۸e a vu la mise en ﺧuvre de prospections gﺣ۸ophysiques (mesures de rﺣ۸sistivitﺣ۸ magnﺣ۸tique AMP), prﺣ۸alables ﺣ un nouveau programme dﻗexploration de lﻗoppidum sur une plus large ﺣ۸chelle. La reconnaissance, au nord et ﺣ lﻗest de la zone fouillﺣ۸e, dﻗanomalies magnﺣ۸tiques dﻗorientation et dﻗorganisation cohﺣ۸rentes avec celles des vestiges de lﻗoppidum latﺣ۸nien dﺣ۸jﺣ dﺣ۸gagﺣ۸s, tend ﺣ confirmer quﻗil sﻗﺣ۸tend sur plusieurs dizaines dﻗhectares. Cette hypothﺣ۷se sera validﺣ۸e dans le cadre dﻗun nouveau programme de fouille triannuel envisagﺣ۸ pour 2009-2011.




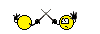 .
.
 sur une prﺣ۸tendue inscription "Cecos ac Caesar" = "Merde ﺣ Cﺣ۸sar", sur une balle de fronde qui n'existe pas
sur une prﺣ۸tendue inscription "Cecos ac Caesar" = "Merde ﺣ Cﺣ۸sar", sur une balle de fronde qui n'existe pas