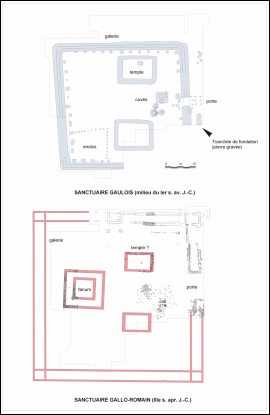Mﺣ۹me remarque pour le plan, "ﺣ peu prﺣ۷s" carrﺣ۸ de ces trois sanctuaires - en fait, franchement parallﺣ۸lﺣ۸pipﺣ۸dique ou trapﺣ۸zoﺣﺁdal, avec une branche rentrante et des angles arrondis.
Visiblement, les perpendiculaires n'ﺣ۸taient guﺣ۷re apprﺣ۸ciﺣ۸es de nos architectes gaulois, qui savaient pourtant tracer des plans au cordeau, en utilisant des canons mﺣ۸triques prﺣ۸cis au dﺣ۸cimﺣ۷tre prﺣ۷s.
Un dﺣ۸tail parmi d'autres : l'espace mesurﺣ۸ entre chaque poteau de la galerie monumentale est de 3 m 20, d'axe en axe. Soit, trﺣ۷s exactement. l'ﺣ۸quivalent de dix pieds grecs (attiques = 32 cm). Le parallﺣ۷le pourrait sembler purement fortuit. Mais cette mesure de dix pieds correspond, prﺣ۸cisﺣ۸ment, ﺣ l'espacement-type des colonnades classiques et hellﺣ۸nistiques.
Pour le reste, il semble que les considﺣ۸rations ou prescriptions d'ordre symbolique ou rituel primaient sur le respect de la norme orthogonale. Une diffﺣ۸rence notable avec les Grecs classiques, qui ont privilﺣ۸giﺣ۸ l'angle droit comme point de dﺣ۸part d'une ordonnance du monde ﺣ l'image de nos centres-ville modernes...
Truisme : les Celtes du second ﺣ۱ge du Fer, dont Poseidonios affirme qu'ils n'ignoraient pas les thﺣ۸ories de Pythagore, n'avaient pas tout ﺣ fait la mﺣ۹me vision que Socrate ou Ictinos. La forme de leurs sanctuaires, qui ont pourtant bﺣ۸nﺣ۸ficiﺣ۸ d'une conception architecturale particuliﺣ۷rement soignﺣ۸e, souligne les limites de la comparaison avec leurs voisins mﺣ۸diterranﺣ۸ens.