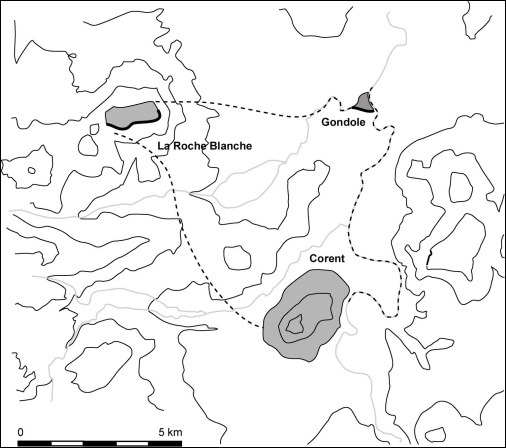|
Urbs et oppidumModÃĐrateurs: Pierre, Guillaume, Patrice
66 messages • Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
La dualitÃĐ sanctuaire/oppidum avec ÃĐloignement de quelques kms semble Êtred'une large frÃĐquence dans le monde gallo-romain, une vraie spÃĐcificitÃĐ d'origine celte ?
Pour ajouter à la liste je mentionerais ALLONES/VINDINUM chez les Aulerques Cenomans......je note ÃĐgalement la relative proximitÃĐ de QuiÃĻvrecourt et de Fesques en limite des territoires CalÃĻtes VÃĐliocasses et Bellovaques.... Et puisqu'on parle de configurations (proto) urbaines, je ne peux m'empÊcher de mentionnes ces curieuses structures de mÃĐandres qu'on trouve sur la Seine - MÃĐandre totalement barrÃĐ d'un murus gallicus (le mur St Phillibert) sur le mÃĐandre de JumiÃĻges et (paraÃŪt-il) un systÃĻme identique aurait laissÃĐ des traces sur le mÃĐandre au Sud de Rouen entre Orival et Grand Couronne.....Pourquoi de telles fortifications sur des kilomÃĻtres ? Y'at'il un rapport avec la structure de Vesontio (sur un mÃĐandre) chez les SÃĐquanes ?
Pour en revenir à la pÃĐriode de La TÃĻne et au problÃĻme qui m'occupe : La contemporanÃĐitÃĐ des oppida de Gergovie, Corent et Gondole sur une brÃĻve pÃĐriode centrÃĐe sur le milieu du Ier siÃĻcle (LT D2b, Guerre des Gaules) est clairement ÃĐtablie par les ÃĐtudes de mobilier. Or, les trois sites ne sont distants que de 5 à 7 kilomÃĻtres. Ils dominent un triangle de 1800 à 2000 hectares, traversÃĐ par le cours de l'Allier. Chacun apporte la piÃĻce d'un puzzle qui ne peut Être perçu de maniÃĻre isolÃĐe : sanctuaire de CitÃĐ, atelier monÃĐtaire et habitat à Corent, vestiges de bataille mais absence de rempart (latÃĐnien) d'habitat à Gergovie, rempart et habitat à Gondole... L'idÃĐe de les concevoir comme trois pÃīles constitutifs d'une seule et mÊme entitÃĐ urbaine (citadelles fortifiÃĐes et sanctuaire contrÃīlant un vaste espace alternant terres agricoles et zones bÃĒties) ÃĐvite les querelles de clocher. Elle trouve des ÃĐchos intÃĐressants dans le livre VII du Bellum Gallicum, qui distingue clairement l'urbs/oppidum des positions gauloises rÃĐparties sur les sommets environnants. D'oÃđ la tentation de considÃĐrer le site historique du plateau de La Roche Blanche comme une citadelle (arx), un site refuge occupÃĐ ponctuellement, faisant partie d'un ensemble beaucoup plus ÃĐtendu, dÃĐsignÃĐ par CÃĐsar sous le nom gÃĐnÃĐrique de Gergovie. Cette mÃĐgalopole gergovienne me paraÃŪt à la mesure du territoire arverne. Pour comparaison, des "oppida" de 500, 700 (Kelheim, Altenburg) ou mÊme 1600 hectares (Heidengraben prÃĻs Grabenstetten) sont bien attestÃĐs à l'est du Rhin. J'argumenterai la chose plus en dÃĐtail dÃĻs que j'aurai achevÃĐ la rÃĐdaction de l'article et attends vos commentaires, en attendant...
Tu pourras nous donner la rÃĐfÃĐrence de cet article? Moi ça m'intÃĐresse beaucoup en tout cas. A+ Patrice
Bonjour
Un peu de visuel avec une petite carte : http://www.ot-gergovie.fr/pays/pays.htm Mais oÃđ se situe Gondole, vers Saint Georges Muskull / Thomas Colin
Comme l'eau modÃĻle la terre, la pensÃĐe modÃĻle le possible. http://muskull.arbre-celtique.com/ http://thomascolin.fr
Super ! Merci pour la carte
En fait Gondole est au confluent de l'Allier et de l'Auzon et nous avions un peu parlÃĐ d'une dÃĐcouverte funÃĐraire rÃĐcente : Huit hommes et leurs chevaux : une sÃĐpulture multiple en terre arverne (Le Cendre, Puy-de-DÃīme). http://www.inrap.fr/www/actualite/communique.aspx?id=61 Les trois sites dessinent en effet un triangle quasi ÃĐquilatÃĐral et au centre nous avons Les Martres de Veyres à l'ÃĐtymologie intÃĐressante et grand centre ÃĐconomique au moyen ÃĒge (voir le lien prÃĐcÃĐdent). Mais aussi auparavant : J.-R. Terrisse, Les cÃĐramiques sigillÃĐes gallo-romaines de Martres-de-Veyres (Puy-de-DÃīme), 1968, 162 p., 55 fig., LVIII pl. Ce n'est pas grand chose mais il est possible que le port latÃĐnien se trouvait aussi là , mais pas de fouilles à ce niveau apparemment. Muskull / Thomas Colin
Comme l'eau modÃĻle la terre, la pensÃĐe modÃĻle le possible. http://muskull.arbre-celtique.com/ http://thomascolin.fr
"...Gondole est au confluent de l'Allier et de l'Auzon ..."
N'y aurait-il pas là dedans la racine *dol- = mÃĐandre ? + *con- = ensemble, > confluent ? Qu'en dit la toponymie locale ? Qu'en pense Ronan ? JCE "Apprends tout et tu verras que rien n'est superflu".
Hugues de Saint-Victor.
Cette lecture est inÃĐdite, Ã ma connaissance : la toponymie locale est plutÃīt en retard en matiÃĻre de linguistique celtique. J'en profite pour vous soumettre une autre colle : l'ÃĐtymologie du toponyme Gergovie. Selon Lacroix et Delamarre, il est formÃĐ Ã partir du prÃĐ-celtique Gerg- ou Gaer- signifiant "la montagne forte", "la citadelle", ce qui cadre bien avec la situation du plateau de Merdogne et le texte de CÃĐsar. Mais qu'en est-il du suffixe -govia (dÃĐcomposÃĐ par Lacroix en g-o-via) ? Une ÃĐtymologie ancienne, qui souligne sa parentÃĐ avec l'all. Gau (le canton), y voit l'expression d'une dualitÃĐ : "La forteresse du pays"... Qu'en pensent les linguistes ? DerniÃĻre ÃĐdition par Adcanaunos le Jeu 17 FÃĐv, 2005 17:03, ÃĐditÃĐ 1 fois.
J'ai trouvÃĐ Ã§a.
"Depuis la Renaissance, on identifie Gergovie à un vaste plateau basaltique de 70 ha, situÃĐ Ã quelques kilomÃĻtres au sud de Clermont-Ferrand (dÃĐpartement du Puy-de-DÃīme). Ce plateau domine le village qui portait le nom de Merdogne, troquÃĐ en 1865 contre celui de Gergovie (commune de La Roche-Blanche). Le nom antique a probablement ÃĐtÃĐ conservÃĐ, dÃĐformÃĐ, comme toponyme sur le flanc sud-est du plateau, mentionnÃĐ dÃĻs le Xe siÃĻcle (sous les formes Gergoia, Girgia, etc.)." Vincent Guichard, directeur de recherche au Centre archÃĐologique du Mont Beuvray. Muskull / Thomas Colin
Comme l'eau modÃĻle la terre, la pensÃĐe modÃĻle le possible. http://muskull.arbre-celtique.com/ http://thomascolin.fr
Salut,
Sur l'ÃĐtymologie de Gergovie, la rÃĐponse se trouve peut-Être chez Degavre: Jean Degavre, "Lexique gaulois", t. 1, 1998, Bruxelles, MÃĐmoires de la SociÃĐtÃĐ Belge d'Etudes Celtiques, 9, p. "*GERWO- *rude, rÊche cf. v irl garb, gall garw (<*ghr-wo-), bret garÃī = "rude", skr hÃĄrsate= "il devient raide", gr XÃĐrsos= "sec, rude", lat horrere= "Être hÃĐrissÃĐ". § gallo-roman; > m fr guerpe = "ÃĒpre". Le celtique commun *Gerwo- postulÃĐ par Degavre rÃĐpond bien au *Gergo- donnÃĐ par Lacroix (Jacques Lacroix, "Les noms d'origine gauloise", 2003, Paris, Errance, p. 126), cependant je ne vois pas ce qui permet à Lacroix de dire que c'est "prÃĐ-celtique". Sur la finale -via, la rÃĐponse peut-Être tout simplement un homonyme du latin via, "route". Cet homonyme n'est pas attestÃĐ en celtique ancien, mais on peut considÃĐrÃĐ un fait curieux: les divinitÃĐs de carrefours, les biviae, triviae, etc., malgrÃĐ leur nom a priori latin, ne sont rÃĐellement attestÃĐe que sur les anciens territoires celtiques. Ainsi, Gergovie pourrait Être une "Apre Route" (sur le modÃĻle des Apremont, Aspremont de la toponymie française), ce que confirme CÃĐsar qui dit (pour reprendre la citation faite par Lacroix): "situÃĐ sur une trÃĻs autre montagne, dont tous les accÃĻs ÃĐtaient difficiles". J'ai du mal à accepter dans ce cas l'hypothÃĻse du double suffixie -u-ia, qui n'apparaÃŪt semble-t-il qu'au masculin, dans des noms de peuples (Esuvii, Lexovii, Kornovii, etc.), sauf dans le cas de Segovia qui pourrait aussi s'expliquer par mon hypothÃĻse: "Chemin de la Victoire". Des suggestions? A+ Patrice
Autre solution qui me vient à l'esprit.
On peut aussi avoir un doublon *Gerg- covia, avec covia comme variante du thÃĐonyme Cobeia (connu à Mandeure, Doubs)? Je ne sais pas si on passe aisÃĐment de "b" à "v" en gaulois... Mais on a par exemple l'anthroponyme Bellicovia (à Paris, CIL 13 11275), qui pourrait s'expliquer par "Forte Victoire". Et donc Gergovia pourrait Être l'"Apre Victoire"? A+ Patrice
Heil Siegfried Patricius :
Je trouve des propositions voisines de la "force" dans l'analyse de SEGEDUNUM / Wallsend (extrÃĐmitÃĐ est du Mur d'Hadrien), chez Rivet & Smith. Ils citent ÃĐgalement plusieurs toponymes de ce type en Gaule, à commencer par SEGEDUNUM RUTENORUM : Rodez ! Vu d'ici, du nord de la P. Bretagne, Rodez n'est somme toute pas trÃĻs ÃĐloignÃĐe de Gergovie. Mais pour la terminaison -ov- de SEGOV-ia, (Segovie, Espagne), j'y verrais plutÃīt un pluriel celtique (gallois -au, breton -ou), sorte d'accusatif, auquel aurait ÃĐtÃĐ sur-ajoutÃĐ la terminaison latine -ia.. Si ça peut faire avancer le schmilblik ! JCE "Apprends tout et tu verras que rien n'est superflu".
Hugues de Saint-Victor.
(si l'on conserve la lecture du Gerg- comme "place forte") Voila qui cadrerait pas mal avec ma perception d'un site gardÃĐ par plusieurs postes gardÃĐs, rÃĐpartis sur plusieurs ÃĐminences...
La lecture de Patrice est tout aussi sÃĐduisante. Si mes souvenirs sont bons, l'inrterchangeabilitÃĐ des dentales "b" et "v" est une caractÃĐristique des langues indo-europÃĐennes (cf. l'ÃĐvolution de la prononciation du "bÊta" grec ancien au grec moderne).
"L'Apre victoire" : Camille Jullian lui-mÊme n'y avait pas pensÃĐ. Je prÃĐcise, à toutes fins utiles, que Gergovie existait dÃĐjà AVANT l'arrivÃĐe de CÃĐsar en Auvergne, la victoire de VercingÃĐtorix et sa dÃĐfaite consÃĐcutive.
Certes, mais quand on voit le nombre d'oppidum qui sont en sego-, ou bien la liste des noms de lieu issu de cobo-, (tous deux ayant le sens de "victoire"), il doit y avoir là dedans quelque chose qui n'a rien rien à voir avec des ÃĐvÃĐnements historiques, mais ce doit Être plutÃīt une sorte de superlatif (comme on en trouve plein dans l'anthroponymie gauloise). Ainsi, Segodunum, "Fort de la Victoire", devrait Être compris dans le sens "L'invincible". A+ Patrice
66 messages • Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Retourner vers Histoire / ArchÃĐologie Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistrÃĐ et 50 invitÃĐs
Accueil |
Forum |
Livre d'or |
Infos Lègales |
Contact
Conception : Guillaume Roussel - Copyright © 1999/2009 - Tous droits rèservès - Dèpôts INPI / IDDN / CNIL(1006349) / SCAM(2006020105) | |