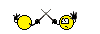"Les Celtes ﺣ۸mergent de lﻗanonymat des peuples sans ﺣ۸criture de lﻗEurope ancienne au VIe siﺣ۷cle avant J.-C. Sﺣ۸parﺣ۸e alors depuis probablement prﺣ۷s de deux millﺣ۸naires du tronc indo-europﺣ۸en, leur famille linguistique avait dﺣ۸jﺣ derriﺣ۷re elle, ﺣ cette ﺣ۸poque, un long passﺣ۸ et se rﺣ۸partissait en plusieurs groupes distincts qui occupaient de vastes territoires en Europe centrale et occidentale."
.../...
"La celtisation de lﻗEurope ﺣ۸tait donc amplement engagﺣ۸e bien avant lﻗentrﺣ۸e des Celtes dans lﻗhistoire et la naissance de la civilisation de La Tﺣ۷ne qui lﻗaccompagne au Ve siﺣ۷cle avant J.-C. La diffusion successive de cette civilisation ﺣ partir de son aire initiale a ﺣ۸tﺣ۸ longtemps considﺣ۸rﺣ۸e comme le symptﺣﺑme le plus sﺣﭨr et le plus ﺣ۸vident de lﻗexpansion des Celtes ; elle ne reflﺣ۷te en fait que la derniﺣ۷re ﺣ۸tape des mouvements migratoires du seul groupe central. "
.../...
"Lﻗexpansion militaire fut remplacﺣ۸e aux siﺣ۷cles suivants ( IIﺡﺍ et Iﺡﺍ S.)par une colonisation urbaine qui correspond ﺣ lﻗapparition et ﺣ lﻗessor des oppida ﻗ agglomﺣ۸rations fortifiﺣ۸es des Celtes qui reﺣ۶urent ce nom ﺣ partir du terme utilisﺣ۸ dans les textes latins. Cﻗest alors que se constituent dans leur forme dﺣ۸finitive les citﺣ۸s-ﺣtats ﻗ civitates ﻗ dﺣ۸crites en Gaule par Cﺣ۸sar et perceptibles encore aujourdﻗhui dans lﻗorganisation du territoire franﺣ۶ais."
W. KRUTA
C'est donc trﺣ۷s rﺣ۸cent dans l'histoire celtique...
La religion des "cavaliers"
"Le nomadisme pastoral est plus tardif que l'agriculture et contemporain d'une virilisation des figures et de sanctuaires oﺣﺗ s'effectuaient des sacrifices sanglants, y compris humains. C'est l'inondation du golfe Arabo-persique et la fin du dﺣ۸luge, le retour ﺣ un temps sec. C'est aussi l'ﺣ۸poque du culte des crﺣ۱nes, qui sont dﺣ۸tachﺣ۸s du corps, parfois modelﺣ۸s et coiffﺣ۸s, et qui sont exposﺣ۸s dans ou ﺣ l'extﺣ۸rieur des maisons carrﺣ۸es (Ka'ba) et non plus rondes. Cette pratique est sans doute ﺣ rapprocher des futures momies ﺣ۸gyptiennes et du culte des ancﺣ۹tres. On suppose aussi la pratique de banquets oﺣﺗ se rﺣ۸unit la communautﺣ۸.
Le nomadisme, amplifiﺣ۸ par la nouvelle sﺣ۸cheresse, va accﺣ۸lﺣ۸rer l'expansion du nﺣ۸olithique, surtout en touchant des populations qui vont pouvoir passer directement du nomadisme de cueilleur-chasseur ﺣ celui d'ﺣ۸leveur nomade, prﺣ۸servant des ﺣ۸lﺣ۸ments archaﺣﺁques dans la nouvelle religion. Cette diffusion se fera en mﺣ۹me temps que celle de la langue dite indo-europﺣ۸enne.
La religion de ces ﺣ۸leveurs nomades nous est en partie accessible par ce que nous savons des religions indo-europﺣ۸ennes, bien que beaucoup plus tardives et qui se retrouvent de l'Inde ﺣ l'Iran, aux Scythes, aux Celtes, aux Slaves et aux Germains. Ces peuples nomades devaient protﺣ۸ger leur bien, objet de convoitise, ﺣ moins qu'ils ne vivent de rapines comme les premiers grecs (d'aprﺣ۷s Thucydide) ou les premiers Romains, formant, donc, une classe de guerriers. La prﺣ۸pondﺣ۸rance de l'homme dans cette organisation ainsi que l'attention de ces populations aux problﺣ۷mes de reproduction s'exprime dans une religion patriarcale et le culte des hﺣ۸ros. L'unitﺣ۸ de la vie et de la mort (Si la mort sort de la vie, la vie en revanche sort de la mort. Hegel p62) est affirmﺣ۸e dans les cﺣ۸rﺣ۸monies phalliques. Les initiations guerriﺣ۷res, les rites du Soma ou de l'Ambroisie donnent aux guerriers l'espoir de l'immortalitﺣ۸. Les sacrifices ﺣ۸voluent de leur fonction magique ﺣ un ritualisme formaliste qui se rﺣ۸duit ﺣ affirmer l'unitﺣ۸ de la communautﺣ۸ ("ON DIT QU'ON S'EST INSTALLﺣ LORSQU'ON A CONSTRUIT UN AUTEL" Satapatha Br. VII, I,I,I-4). Le banquet restera, chez les Grecs ou les Gaulois le rite principal de la communion.
On peut dﺣ۸duire qu'issues de la religion du taureau (Mithra) mais s'ﺣ۸loignant d'une culpabilitﺣ۸ originelle, la religion se rﺣ۸duit au social, reflﺣ۸tant les fonctions efficaces de l'organisation de la sociﺣ۸tﺣ۸ ; religion plus utilitaire, au service du pouvoir, et qui se renforcera de l'ﺣ۱ge du bronze ﺣ l'ﺣ۱ge du fer."
http://perso.wanadoo.fr/marxiens/philo/ ... ligion.htm
Patrice a ﺣ۸crit :
Bref, il y a des choses qui ne vont pas dans tes raisonnements, des conceptions trop thﺣ۸orique qui ne tiennent pas compte de la multitude de rﺣ۸alitﺣ۸s.
Dans le comparatisme en histoire des religions il est nﺣ۸cessaire de brasser large dans un premier temps, les grands courants puis les spﺣ۸cificitﺣ۸s. Si l'on commence par comparer Bourges et Tabriz ﺣ plus de 10 siﺣ۷cles d'intervalle, on ne s'en sort pas...