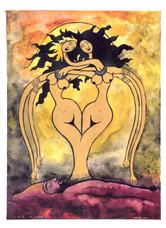Je suis en train de mettre en ligne une page spÃĐcifique sur l'ÃŪle de Thanet, à l'extrÊme sud-ouest de l'ÃŪle de Bretagne, dans le Kent, entre la mer du Nord et la Pas de Calais / DÃĐtroit de Douvres.
Je suis ouvert à toute prÃĐcision ou observation constructive.
http://marikavel.org/angleterre/thanet/thanet-accueil.htm
JCE