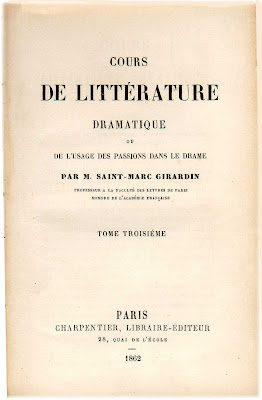Mais, concernant la volontÃĐ de "faire oeuvre d'historien" de Geoffroy dans son "Historia", je dirais mÊme que ça contraste assez violemment avec sa "Vie de Merlin" qui est beaucoup plus poÃĐtique
Quand à vouloir atteindre un public large et un peu variÃĐ = bretons, normands, celtes insulaires (l'ennnemi de mon ennemi...)
1137 = j'ai parfois trouvÃĐ, ici ou là , la date 1138 au lieu de 1135, pour l'achÃĻvement de l'"Historia"...
C'est plus de l'Histoire, là , c'est du flash-info, que ça allait devenir !